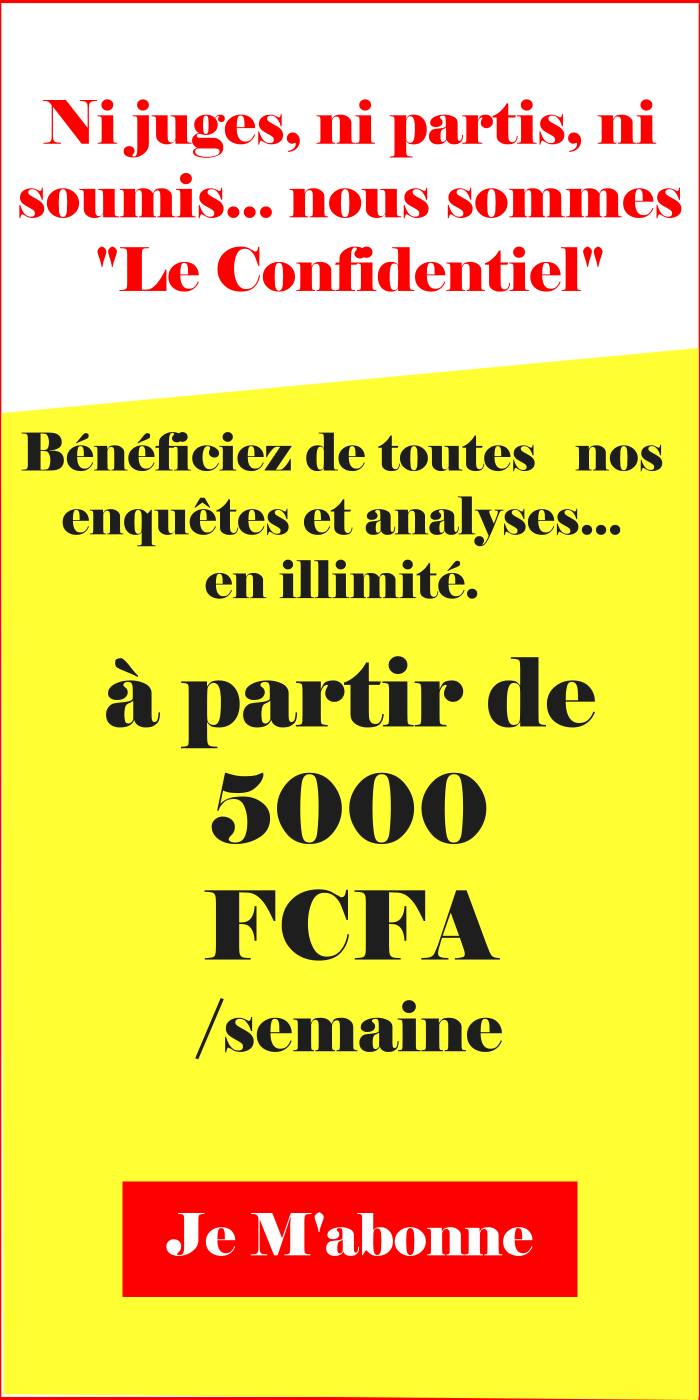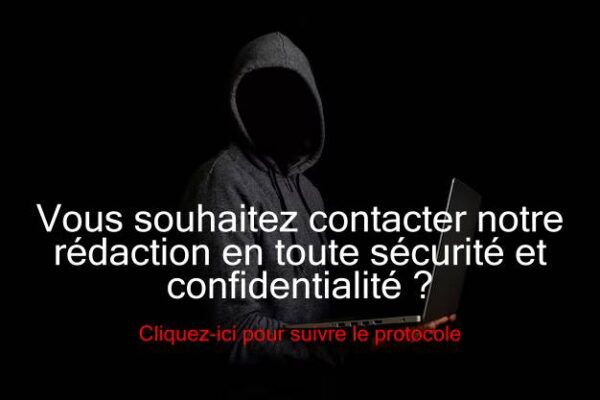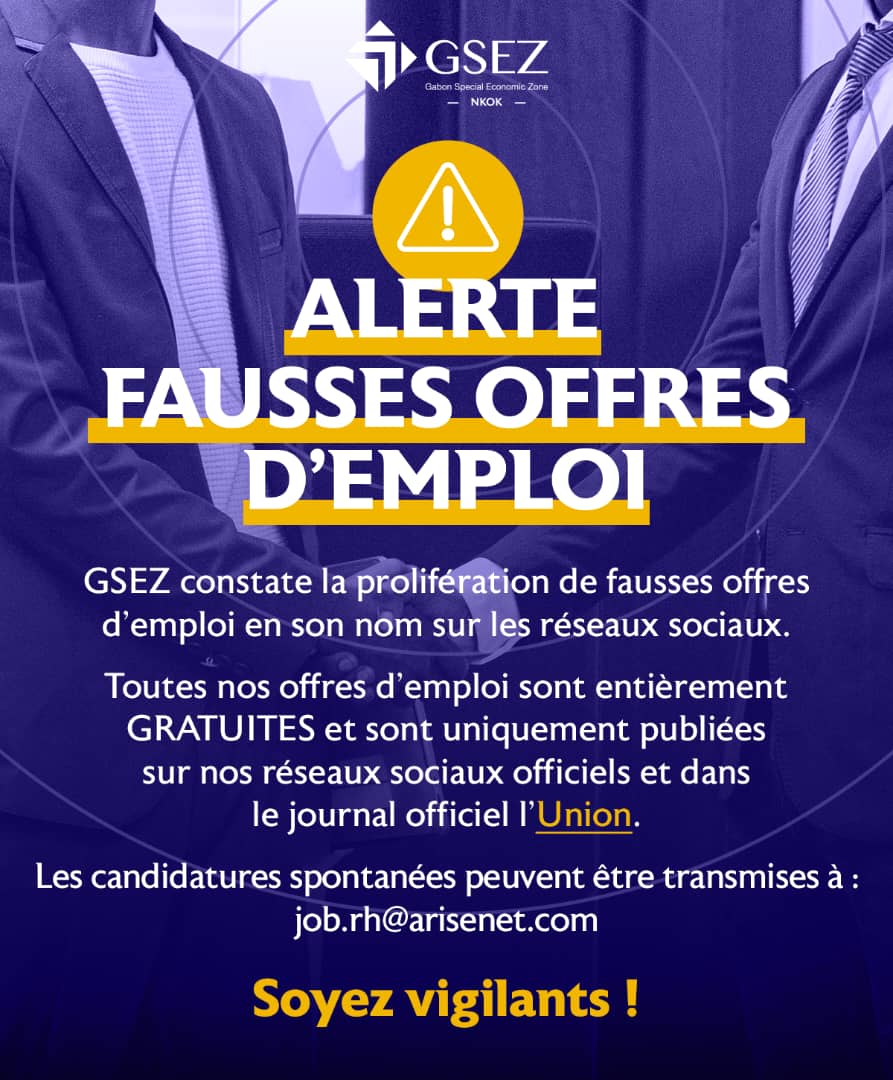Cette situation résulte d’un bras de fer persistant entre les autorités monétaires régionales et les firmes pétrolières concernant l’application d’une réglementation édictée en 2018 par la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC). La banque centrale ambitionne de rapatrier ces fonds, majoritairement logés dans des banques étrangères, sur des comptes qu’elle contrôle. L’objectif affiché est de consolider les réserves de change des États membres, fragilisées par des conjonctures économiques délicates.
Cependant, à l’approche de la date limite et des menaces de sanctions immédiates à compter du 1er mai, les divergences persistent. Les compagnies pétrolières arguent que ces fonds sont dédiés à des usages spécifiques de restauration environnementale. Elles soulignent également que, conformément aux directives du Fonds monétaire international (FMI), ces sommes ne peuvent être comptabilisées ni dans les réserves brutes ni dans les réserves nettes des pays. Un responsable du secteur a par ailleurs précisé que les versements sur les comptes séquestres environnementaux sont progressifs, corrélés à l’avancement des projets et à leur phase de déclin de production. Certains projets en phase initiale n’ayant ainsi effectué aucun dépôt, suggérant une possible surestimation des montants attendus par les gouvernements.
Seul l’opérateur français Perenco a publiquement fait état de négociations en cours avec les parties prenantes régionales pour parvenir à un accord avant l’échéance, affirmant se conformer déjà à la réglementation en vigueur. Les autres acteurs majeurs du secteur opérant en Afrique centrale, tels que Kosmos Energy, Chevron, Vaalco Energy et TotalEnergies, n’ont pas donné suite aux sollicitations.
Selon une source proche du dossier, le montant recouvré pourrait s’établir à moins de 500 millions de dollars début mai, avec une projection d’atteindre potentiellement 1 milliard de dollars sur la prochaine décennie. Ces chiffres contrastent fortement avec les attentes initiales des pays de la CEMAC, dont les autorités gabonaises avaient évoqué en janvier dernier des retombées potentielles de 3 000 à 6 000 milliards de francs CFA (soit 5 à 10 milliards de dollars). Les 500 millions de dollars actuels ne représentent qu’environ un dixième de ce que les six États espéraient pour revigorer leurs économies.
Le blocage des discussions porte également sur le refus de la BEAC de renoncer à son immunité souveraine d’exécution, un point de friction majeur qui rendrait inapplicables d’éventuelles décisions de justice à son encontre. Ce différend a même attiré l’attention du Congrès américain, où des parlementaires républicains ont critiqué la position de la CEMAC et menacé de bloquer l’aide du FMI à la région. Le FMI, créancier important de la zone, a déclaré suivre attentivement la situation et prévoit une mission dans la région après ses réunions de printemps.
L’impasse actuelle fait planer une menace significative sur les futurs investissements dans la région. Le mois dernier, S&P Global Insights a estimé que la CEMAC pourrait perdre environ 45 milliards de dollars d’investissements d’ici 2050 si la nouvelle réglementation sur les devises était mise en œuvre, soit une chute de 54 % par rapport au scénario de référence. Une source industrielle a confirmé à Reuters que son entreprise suspendrait tout nouvel investissement tant qu’une résolution positive ne serait pas trouvée.
Ce bras de fer met en lumière la complexité des relations entre les États d’Afrique centrale et les investisseurs étrangers, ainsi que les défis liés à la mobilisation des ressources financières pour la transition écologique et le renforcement de la stabilité macroéconomique dans la région. La résolution de cette crise sera cruciale pour préserver l’attractivité de la CEMAC et éviter une contraction significative des flux d’investissements à long terme.